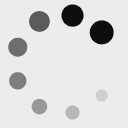Je déboule à Kaboul

| Réalisateur | Azam Olivier |
| Partager sur |
Afghanistan, Kaboul 2002. Début de l’opération de "libération" de l’Afghanistan dans un climat totalement euphorique et troublant. Le réalisateur-monteur est missionné pour "sauver la démocratie" par les images ! Interdites par le régime taliban pendant des années, les images refont subitement surface, suscitant de nombreuses interrogations à chaque instant de part et d’autre... Ce carnet de montage raconte de l’intérieur cette aventure rocambolesque, l’espoir des Afghans et les contradictions des occidentaux qui viennent ici.
A l’image de son titre, le film est parcouru d’une autodérision visant à désacraliser la mission « civilisatrice » que le réalisateur s’apprête à entreprendre auprès d’Afghans dont il ne connaît rien et surtout pas la langue. Il se met en scène, tour à tour acteur, réalisateur, citoyen, sa caméra lui permettant de mettre un peu de distance avec ce qu’il devine déjà être une « illusion » et dont il se sent un peu le complice. Le film s’achève sur l’accession de Jean-Marie Le Pen au second tour des élections présidentielles alors que l’Afghanistan organise ses premières élections libres. Les Afghans se moquent des Français et leur proposent l’asile politique. Je déboule à Kaboul est un film, drôle, sensible, parcouru d’une ironie qui n’enlève rien au sérieux du sujet et qui, dix ans, après reste toujours aussi pertinent sur l’interventionnisme militaire et sur le rapport de l’Occident avec le reste du monde.
Un carnet de voyage
Avril 2002, je déboule à Kaboul libérée du régime taliban depuis à peine six mois. Dans ce pays interdit d’images depuis des années, et n’ayant connu que la guerre depuis plus de 25 ans, l’ONG française Aïna lancée par Reza Deghati m’a missionné pour « exporter la démocratie audiovisuelle en Afghanistan à l’aide des technologies numériques ». Concrètement, je dois monter le premier film documentaire tourné à Kaboul après les talibans, et ce film devra aussi servir de support pour former des Afghans au montage virtuel. Ce carnet de montage filmé raconte le « off » des premières heures où les images afghanes ont ressuscité au cœur même d’Afghan Film et du Centre des médias et de la culture de Kaboul. Pendant que nous expliquions la démocratie aux Afghans, la France était sous le choc du premier tour des élections présidentielles... Olivier Azam, 2002
Dix ans plus tard
Il y a 10 ans, en mai 2002, j’étais en route pour Kaboul avec une petite caméra embarquée . Dès mon arrivée, j’ai décidé de tout filmer, de faire en sorte que tous les gens que je croisais pensent que cette petite caméra faisait partie de moi. Et c’est ce qui s’est passé. Quand j’ai atterri à l’aéroport de Kaboul, une explosion à retenti dans l’indifférence générale et j’ai aussitôt décidé que j’étais dans un film. Sur le fond, je ne voulais rien rater de l’espoir des Afghans, des contradictions des occidentaux. Il y avait quelque chose de fascinant à tourner et monter des images dans un pays où elles avaient été interdites pendant des années. Peut être aussi, comme souvent, c’était une façon de se planquer derrière un objectif, mettre un peu de distance pour se protéger de ce que je sentais déjà comme un faux espoir vendu par l’occident et dont j’étais un peu complice en venant ici.
Globalement, l’action de la France en Afghanistan était effectivement une promesse de Gascon, ce qui plus tard m’apparaîtra clairement comme l’expression de "l’impérialisme humanitaire" (selon l’expression de Jean Bricmont) et que l’on retrouve à chaque fois, en Irak ou encore en Libye et la question se pose toujours partout où l’occident à des intérêts autres qu’humanitaires. Cette idée prétentieuse que nous, gens civilisés de l’occident, on irait sauver le reste du monde, désigner l’équipe des "gentils", vendre la démocratie partout - et quelques autres babioles - à des petits enfants qui ignorent tout de la vie. Dans les médias, la propagande de guerre nous vend toujours de la bonne conscience en tête de gondole pendant que d’autres (ou les mêmes d’ailleurs) continuent à vendre des armes et se moquer des vraies questions humanitaires.
La seule action efficace serait de NE PAS vendre ces armes, NE PAS soutenir des dictateurs amis, NE PAS imposer de force un système dont on ne veut même plus chez nous. Hypocrisie récurrente dénoncée depuis longtemps par l’intellectuel américain Noam Chomsky (Voir le film Chomsky & Cie) et qui trouvait en Afghanistan un très bon terrain, tellement il était miné et que les ennemis y étaient féroces.
Six mois après la "libération" de Kaboul, j’avais donc le loisir d’observer les premiers pas d’une force d’occupation, dont nous étions provisoirement et plus ou moins consciemment "embeded". Bien sûr, elle n’était pas aussi barbare que celle des talibans, mais elle arrivait avec ses gros sabots sur son cheval blanc. L’échec était déjà inscrit dans l’ADN de cette opération que les Américains avaient d’abord baptisé « Justice sans limites » (Operation Infinite Justice) puis « Liberté Immuable » (Operation Enduring Freedom). Les "humanitaires" des ONG en étaient la branche civile, armée de caméras et d’ordinateurs, qui arrivaient dans le même genre de caisses que les munitions et les bouteille de vodka des soldats.
Même si j’étais entouré de gens sympathiques et courageux, au sein d’une initiative généreuse et louable, je n’étais pas dupe de l’échec à long terme de ma mission. J’ai vite adopté une certaine ironie à l’encontre de cette action "humanitaire" à laquelle je participais : L’intérêt de qui servons-nous ? Que disent nos images ? A quoi serviront-elles ? Qu’est-ce qu’on appelle la démocratie ?
Dans un même temps, je fondais d’admiration pour ces Afghans qui étaient autour de moi, leur rationalisme pratique, leur sens de l’humour redoutable, leur goût de la poésie, de la musique, le sens de l’image et leurs bons conseils (bien qu’inutiles) : Comment reconnaître une belle fille sous la burqa... En bon Afghans, sans que je m’en rende vraiment compte, ils m’avaient généreusement troqué une partie de leur immense culture contre mes minuscules connaissances techniques. Pourtant, une question ne m’a pas quitté du début à la fin du voyage et encore aujourd’hui : Qu’est-ce qu’on foutait là ? Olivier Azam, 2012
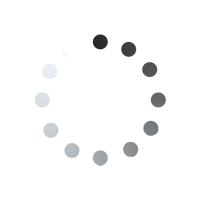
-

Je déboule à Kaboul
Langue : Multilingue
- Produit par Les Mutins de Pangee
- Proposé par <p>Les Mutins de Pangee</p>
- Année de sortie 2004
- Pays de production France
- Langue VOST
- Zone de diffusion Monde
- Disponibilité Location / Vente
- Genre Documentaire
- Durée 1h30
- Identifiant Allociné 199914
Afghanistan, Kaboul 2002. Début de l’opération de "libération" de l’Afghanistan dans un climat totalement euphorique et troublant. Le réalisateur-monteur est missionné pour "sauver la démocratie" par les images ! Interdites par le régime taliban pendant des années, les images refont subitement surface, suscitant de nombreuses interrogations à chaque instant de part et d’autre... Ce carnet de montage raconte de l’intérieur cette aventure rocambolesque, l’espoir des Afghans et les contradictions des occidentaux qui viennent ici.
A l’image de son titre, le film est parcouru d’une autodérision visant à désacraliser la mission « civilisatrice » que le réalisateur s’apprête à entreprendre auprès d’Afghans dont il ne connaît rien et surtout pas la langue. Il se met en scène, tour à tour acteur, réalisateur, citoyen, sa caméra lui permettant de mettre un peu de distance avec ce qu’il devine déjà être une « illusion » et dont il se sent un peu le complice. Le film s’achève sur l’accession de Jean-Marie Le Pen au second tour des élections présidentielles alors que l’Afghanistan organise ses premières élections libres. Les Afghans se moquent des Français et leur proposent l’asile politique. Je déboule à Kaboul est un film, drôle, sensible, parcouru d’une ironie qui n’enlève rien au sérieux du sujet et qui, dix ans, après reste toujours aussi pertinent sur l’interventionnisme militaire et sur le rapport de l’Occident avec le reste du monde.
Un carnet de voyage
Avril 2002, je déboule à Kaboul libérée du régime taliban depuis à peine six mois. Dans ce pays interdit d’images depuis des années, et n’ayant connu que la guerre depuis plus de 25 ans, l’ONG française Aïna lancée par Reza Deghati m’a missionné pour « exporter la démocratie audiovisuelle en Afghanistan à l’aide des technologies numériques ». Concrètement, je dois monter le premier film documentaire tourné à Kaboul après les talibans, et ce film devra aussi servir de support pour former des Afghans au montage virtuel. Ce carnet de montage filmé raconte le « off » des premières heures où les images afghanes ont ressuscité au cœur même d’Afghan Film et du Centre des médias et de la culture de Kaboul. Pendant que nous expliquions la démocratie aux Afghans, la France était sous le choc du premier tour des élections présidentielles... Olivier Azam, 2002
Dix ans plus tard
Il y a 10 ans, en mai 2002, j’étais en route pour Kaboul avec une petite caméra embarquée . Dès mon arrivée, j’ai décidé de tout filmer, de faire en sorte que tous les gens que je croisais pensent que cette petite caméra faisait partie de moi. Et c’est ce qui s’est passé. Quand j’ai atterri à l’aéroport de Kaboul, une explosion à retenti dans l’indifférence générale et j’ai aussitôt décidé que j’étais dans un film. Sur le fond, je ne voulais rien rater de l’espoir des Afghans, des contradictions des occidentaux. Il y avait quelque chose de fascinant à tourner et monter des images dans un pays où elles avaient été interdites pendant des années. Peut être aussi, comme souvent, c’était une façon de se planquer derrière un objectif, mettre un peu de distance pour se protéger de ce que je sentais déjà comme un faux espoir vendu par l’occident et dont j’étais un peu complice en venant ici.
Globalement, l’action de la France en Afghanistan était effectivement une promesse de Gascon, ce qui plus tard m’apparaîtra clairement comme l’expression de "l’impérialisme humanitaire" (selon l’expression de Jean Bricmont) et que l’on retrouve à chaque fois, en Irak ou encore en Libye et la question se pose toujours partout où l’occident à des intérêts autres qu’humanitaires. Cette idée prétentieuse que nous, gens civilisés de l’occident, on irait sauver le reste du monde, désigner l’équipe des "gentils", vendre la démocratie partout - et quelques autres babioles - à des petits enfants qui ignorent tout de la vie. Dans les médias, la propagande de guerre nous vend toujours de la bonne conscience en tête de gondole pendant que d’autres (ou les mêmes d’ailleurs) continuent à vendre des armes et se moquer des vraies questions humanitaires.
La seule action efficace serait de NE PAS vendre ces armes, NE PAS soutenir des dictateurs amis, NE PAS imposer de force un système dont on ne veut même plus chez nous. Hypocrisie récurrente dénoncée depuis longtemps par l’intellectuel américain Noam Chomsky (Voir le film Chomsky & Cie) et qui trouvait en Afghanistan un très bon terrain, tellement il était miné et que les ennemis y étaient féroces.
Six mois après la "libération" de Kaboul, j’avais donc le loisir d’observer les premiers pas d’une force d’occupation, dont nous étions provisoirement et plus ou moins consciemment "embeded". Bien sûr, elle n’était pas aussi barbare que celle des talibans, mais elle arrivait avec ses gros sabots sur son cheval blanc. L’échec était déjà inscrit dans l’ADN de cette opération que les Américains avaient d’abord baptisé « Justice sans limites » (Operation Infinite Justice) puis « Liberté Immuable » (Operation Enduring Freedom). Les "humanitaires" des ONG en étaient la branche civile, armée de caméras et d’ordinateurs, qui arrivaient dans le même genre de caisses que les munitions et les bouteille de vodka des soldats.
Même si j’étais entouré de gens sympathiques et courageux, au sein d’une initiative généreuse et louable, je n’étais pas dupe de l’échec à long terme de ma mission. J’ai vite adopté une certaine ironie à l’encontre de cette action "humanitaire" à laquelle je participais : L’intérêt de qui servons-nous ? Que disent nos images ? A quoi serviront-elles ? Qu’est-ce qu’on appelle la démocratie ?
Dans un même temps, je fondais d’admiration pour ces Afghans qui étaient autour de moi, leur rationalisme pratique, leur sens de l’humour redoutable, leur goût de la poésie, de la musique, le sens de l’image et leurs bons conseils (bien qu’inutiles) : Comment reconnaître une belle fille sous la burqa... En bon Afghans, sans que je m’en rende vraiment compte, ils m’avaient généreusement troqué une partie de leur immense culture contre mes minuscules connaissances techniques. Pourtant, une question ne m’a pas quitté du début à la fin du voyage et encore aujourd’hui : Qu’est-ce qu’on foutait là ? Olivier Azam, 2012
-

Je déboule à Kaboul
Langue : Multilingue
- Produit par Les Mutins de Pangee
- Proposé par <p>Les Mutins de Pangee</p>
- Année de sortie 2004
- Pays de production France
- Langue VOST
- Zone de diffusion Monde
- Disponibilité Location / Vente
- Genre Documentaire
- Durée 1h30
- Identifiant Allociné 199914