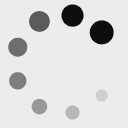Mallé en son exil

| Réalisateur | Gheerbrant Denis |
| Partager sur |
Le monde selon un ancien paysan d’un petit village du Mali. Comme tant d’autres, il nettoie nos cages d'escalier et sort nos poubelles. Au travail, au foyer, parmi ses compatriotes, il avance avec le cinéaste dans l’exploration de son univers, celui que lui ont légué ses nobles ancêtres. L’exploration d’un monde au regard du notre, au fil des jours durant cinq années.
UNE COLLECTION AUTOUR DES FILMS DE DENIS GHEERBRANT
Denis Gheerbrant est l’auteur d'une dizaine de films documentaires pour le cinéma qui s’inscrivent dans la continuité du Cinéma direct. Ils initient une démarche et une esthétique qui ont influencé le cinéma documentaire à partir des années 80.
CinéMutins lui consacre une collection de films qui viendront peu à peu.
LE RISQUE DE L'AUTRE (PAR LAURENT ROTH)
À chacun de ses films, Denis Gheerbrant nous rappelle que « La vie est immense et pleine de dangers », comme le voulait le beau titre de son documentaire dans lequel il filmait, sans le moindre naturalisme, un enfant qui affrontait la maladie et la mort.
Avec Mallé en son exil, il sera question d'initiation. C'est le monde des ombres qui nous accueille au début du film, c'est à lui que nous retournons à la fin : quai de RER dans un cas, bus de banlieue dans l'autre, chaque fois, la nuit noire de ceux qui se lèvent avant le blanc de l'aube : Noirs dans le noir, invisibles dans l'invisible.
Le risque de la rencontre avec Mallé le Malien, il tient d'abord à ce pas de côté fait dans l'espace-temps : Mallé est à côté de nous, Mallé est à mille lieues de nous. Filmé pendant cinq ans, Mallé nous convoque sur le territoire de son exil, il nous ouvre son bagage mental, un bagage qu'il n'a jamais déposé en France, en dehors du lieu clos du foyer où il vit à Montreuil.
Mallé est donc une sorte de fantôme.
Denis Gheerbrant filme sa fiction salvatrice, celle d'un Soninké, issu du rang des hommes libres, ces nobles qui assurent des fonctions de guide spirituel, entre l'imam et le sorcier.
C'est un orphelin qui nous raconte les origines, celles du serpent Blida et des vierges qui lui sont sacrifiées, et qui défend son monde : l'esclavage, la polygamie, l'excision.
Mais la fiction de cet autre n'est pas la nôtre.
Ici, en France, Mallé sort nos poubelles et personne ne lui parle.
Sauf le cinéaste, qui se tient devant lui avec une caméra : chacun son fétiche.
LE FIL DE LA PAROLE
La rencontre avec Mallé est donc un malentendu — on pourrait le dire d'ailleurs de tous les personnages des films de Denis Gheerbrant, si l'on veut bien décomposer ce mot : mal entendu.
C'est parce qu'on a du mal à entendre ce que nous dit l'autre qu'il faut déployer un luxe d'attention autour de sa parole.
C'est au fil de l'eau, d'un canal ou d'un lac, que se font souvent les évocations des dieux, des légendes, des paysages de l'enfance, un fil qui joue comme métaphore de la mémoire.
Mais le fil de la parole, ce sont aussi ces conversations plus frontales dans le resserrement de sa chambre, d'un local, ponctuées par un troisième fil, celui du téléphone cette fois...
Le corps de Mallé est ici, mais sa tête est là-bas, sa tête et aussi son sang : là où sont sa femme et ses enfants.
Mallé en son exil donne à voir une parole écartelée, comme en témoignent ces scènes où le personnage raccroche subitement après de longues conversations avec des interlocuteurs que l'on devine souvent au pays.
Mallé est un corps présent et massif, le cinéaste l'aime et le filme, en boubou, souvent couché, beau comme un lion ou une montagne, mais Mallé est aussi une marionnette, son corps est relié à mille fils emmêlés là-bas, au pays, qui viennent l'animer de mouvements secrets.
Comme souvent dans ses films, Denis Gheerbrant joue de deux registres antagonistes pour faire entendre ce conflit : le plan-séquence dans sa durée, le raccord brutal de plan à plan.
On pourrait parler d'un « continu-cassé » où la parole n'est écoutée qu'à partir de ses interruptions.
« Couper, c'est faire entendre ce qui nous dépasse » me disait un jour Denis Gheerbrant.
En point d'orgue de ce fil repris et interrompu, l'eau, les fenêtres, le ciel, font les rimes de la partition écrite à deux mains.
QUI MÈNE LE JEU ?
Car il y a bien finalement deux paroles qui se confrontent dans le film, même si celle du cinéaste est plus discrète.
Le cinéma de Denis Gheerbrant n'enregistre pas la parole, il la crée.
Les rôles s'inversent parfois : le personnage met en scène le filmeur, le rend personnage à son tour, c'est une élaboration commune.
Cette tension entre deux corps, deux présences, s'exprime dans un très beau plan où la caméra, en un lent panoramique, relie le ciel, un arbre dans la cour, l'écran de télévision dans la chambre, une horloge affolée dont l'aiguille court sans fin, des vêtements suspendus, un calendrier, Mallé enfin, qui parle dans sa langue au téléphone sans se soucier du filmeur.
Le filmeur a pris soin, au milieu du plan, de signer sa présence : dans le reflet du miroir, il fait le point et inscrit son corps dans cet espace de la chambre qui devient celui du film.
Jusqu'où le filmeur et le filmé pourront-ils partager le même espace ?
Tant que Denis le cinéaste garde sa position de disciple, écoutant un Mallé détenteur de savoir, le contrat du film tient dans un cadre repéré, celui d'un geste de transmission.
Mais c'est un Français qui filme un Africain du Mali.
Et c'est quand Mallé dira : « Il y a deux choses là-bas que les Français sont contre ça, la polygamie et l'excision. » que les deux mondes vont se séparer...
Le cinéma direct tel que le pratique Denis Gheerbrant, dans une forme d'entêtement naïf, est scandaleux.
Il fait naître une fiction partageable dans la transe cinématographique, jusqu'au moment où une limite est posée au jeu qui semblait sans fin.
La grande fraternité égalitaire du cinéma débouche sur ce paradoxe : elle conduit à d'irréconciliables différences.
C'était déjà, il y a près de soixante ans, la leçon de Chronique d'un été.
À nouveau, dans Mallé en son exil, Mallé le personnage et Denis le cinéaste font surgir ce scandale de l'expérience du cinéma : rendre partageable l'impartageable, rendre égalitaire la tragédie des différences.
Laurent Roth
PARCE QUE C’ÉTAIT LUI, PARCE QUE C’ÉTAIT MOI (par DENIS GHEERBRANT)
Un homme filme un autre homme. « Parce que c'était lui, parce que c'était moi. »
Lui, parce qu'à sa manière unique, travailleur précaire vivant dans un foyer, il est à la fois pétri de la culture de ses ancêtres et au fait du mode de pensée occidental, de par sa curiosité et son éducation dans une école encore très française. Moi, parce que cinéaste qui aime filmer seul, dans le mouvement du quotidien, la parole de l'autre.
Lui et moi, parce qu'un jour Mallé m'a dit : « Tu me fais du bien, je te fais du bien. »
Le tournage s'est étalé sur cinq ans, nous nous voyions quasiment chaque semaine.
Au départ, je voulais filmer les travailleurs du nettoyage, les soutiers de notre économie, en tant que porteurs d'un monde qui nous reste étranger, invisible. De 2010 à 2011, j’ai assisté aux consultations juridiques d'un syndicat, parfois avec la caméra. Mais toutes les personnes que je rencontrais dans ces consultations refusaient de s'engager au-delà. J'en étais venu à penser que ceux qui étaient invisibles voulaient le rester, tout simplement pour se protéger.
J'ai expliqué mon projet à Mallé en deux mots et, contrairement aux autres, il m'a donné rendez-vous et m'a parlé d'une traite durant deux heures. Nous nous sommes revus très souvent, pendant deux mois, sans caméra. Et puis le tournage s'est enclenché tout naturellement : parfois en tête-à-tête, parfois à son travail ou parmi les siens.
M'emmener au foyer où il habitait, ce n'était pas rien, car les autres résidents ne comprenaient pas du tout ce qu'il fabriquait avec ce toubab.
Au fil du temps, le Français qui va voir Mallé dans sa chambre est devenu une silhouette familière.
Mallé et moi discutions sans arrêt.
Au début, il s'est fait le professeur de l'histoire à la fois factuelle et mythique du Mali. Très vite, nous nous sommes mis à converser comme deux compères.
« Ici c'est comme ça, chez nous ça se passe autrement. »
Cette conversation a formé le socle de notre relation, le lieu d'une indispensable confiance.
C'est l'acte même de filmer qui a imposé un autre registre, celui où s'exposaient nos différences.
C'est Mallé qui avançait chaque fois d'un pas quand je le filmais, qui m'apprenait par exemple qu'il avait une famille d'esclaves.
C'est la caméra qui a fait surgir les « questions qui fâchent » : l'esclavage, la polygamie, l'excision.
Le questionnement rebondissait d'un tournage à l'autre :
« Tu m'as parlé de tes esclaves, explique-moi ce que représente l'esclavage au Mali. »
De la description d'une société de castes, nous sommes passés à la « nécessité d'avoir un supérieur », et au rapport homme-femme qui nous a menés à la question de l'excision.
MES FILMS, UN PARTAGE D’EXPÉRIENCE
Mes films proposent avant tout le partage de mon expérience d'une réalité donnée.
Je filmais sans comprendre.
Mallé m'a tout traduit, une fois fini le tournage proprement dit.
Nous revenions à cette occasion sur les points que j'avais envie de creuser, notamment bien sûr la question de l'excision.
La nature de notre relation repose précisément sur nos différences.
La tension que l'on sent monter pour culminer à propos de l'excision désigne le contrat même du film.
Certaines déclarations de Mallé bousculent des valeurs que nous considérons universelles, alors même que mon cinéma fonctionne sur l'association du spectateur à une relation empathique avec les personnes filmées.
Quel travail proposez-vous ici aux spectateurs ?
D.G. —
Pour Mallé, le film était une occasion de mettre en forme son univers intérieur à l'épreuve de l'autre, dans la langue de l'autre. C'est alors que le Mallé qui sort les poubelles se met à incarner la civilisation de ses ancêtres. Un monde se substitue alors à un autre, et Mallé nous ouvre à cet univers dont il se dit « exilé ». Dans ce film, j'interroge quelqu'un d'ailleurs qui vit ici, à côté de nous. Il ne s'agit pas de se convaincre...
Propos recueillis par Marie-Pierre Duhamel Muller, le 19 octobre 2018.
FILMOGRAPHIE DE DENIS GHEERBRANT
Longs métrages documentaires :
- Printemps de square (1980 – 80 min)
- Amour rue de Lappe (1984 – 60 min)
- Question d'identité (1985 – 55 min) – Prix du Filmmaker, Bilan du film ethnographique
- Histoire de parole (1986 – 30 min)
- Et la vie (1991 – 90 min) – Prix de la compétition internationale et de la SCAM au festival « Vues sur les docs » Marseille 91
- La vie est immense et pleine de dangers (1994 – 80 min)
- Grands comme le monde (1998 – 90 min) – Festival de Cannes, sélection ACID
- Le voyage à la mer (2000 – 92 min) – Festival de Cannes, sélection ACID, Prix Planète Vues sur les docs Marseille
- Une lettre à Van der Keuken (2001 – 30 min)
- Après, un voyage dans le Rwanda (2004 – 105 min)
- La République Marseille (2009 – 7 films – 6h) – Festival du Cinéma du Réel
- On a grèvé (2014 – 70 min) – Festival du Cinéma du Réel
Tous les longs métrages, à l'exception du premier, sont sortis en salle.
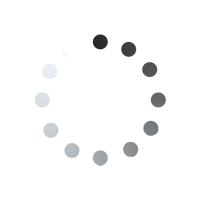
-

Mallé en son exil
Langue : Multilingue
- Produit par L'atelier documentaire, en coproduction avec Les Films d’ici
- Année de sortie 2017
- Pays de production France
- Langue VF
- Zone de diffusion Monde
- Disponibilité Location / Vente
- Genre Documentaire
- Durée 1h46
- Identifiant Allociné 266448.
Le monde selon un ancien paysan d’un petit village du Mali. Comme tant d’autres, il nettoie nos cages d'escalier et sort nos poubelles. Au travail, au foyer, parmi ses compatriotes, il avance avec le cinéaste dans l’exploration de son univers, celui que lui ont légué ses nobles ancêtres. L’exploration d’un monde au regard du notre, au fil des jours durant cinq années.
UNE COLLECTION AUTOUR DES FILMS DE DENIS GHEERBRANT
Denis Gheerbrant est l’auteur d'une dizaine de films documentaires pour le cinéma qui s’inscrivent dans la continuité du Cinéma direct. Ils initient une démarche et une esthétique qui ont influencé le cinéma documentaire à partir des années 80.
CinéMutins lui consacre une collection de films qui viendront peu à peu.
LE RISQUE DE L'AUTRE (PAR LAURENT ROTH)
À chacun de ses films, Denis Gheerbrant nous rappelle que « La vie est immense et pleine de dangers », comme le voulait le beau titre de son documentaire dans lequel il filmait, sans le moindre naturalisme, un enfant qui affrontait la maladie et la mort.
Avec Mallé en son exil, il sera question d'initiation. C'est le monde des ombres qui nous accueille au début du film, c'est à lui que nous retournons à la fin : quai de RER dans un cas, bus de banlieue dans l'autre, chaque fois, la nuit noire de ceux qui se lèvent avant le blanc de l'aube : Noirs dans le noir, invisibles dans l'invisible.
Le risque de la rencontre avec Mallé le Malien, il tient d'abord à ce pas de côté fait dans l'espace-temps : Mallé est à côté de nous, Mallé est à mille lieues de nous. Filmé pendant cinq ans, Mallé nous convoque sur le territoire de son exil, il nous ouvre son bagage mental, un bagage qu'il n'a jamais déposé en France, en dehors du lieu clos du foyer où il vit à Montreuil.
Mallé est donc une sorte de fantôme.
Denis Gheerbrant filme sa fiction salvatrice, celle d'un Soninké, issu du rang des hommes libres, ces nobles qui assurent des fonctions de guide spirituel, entre l'imam et le sorcier.
C'est un orphelin qui nous raconte les origines, celles du serpent Blida et des vierges qui lui sont sacrifiées, et qui défend son monde : l'esclavage, la polygamie, l'excision.
Mais la fiction de cet autre n'est pas la nôtre.
Ici, en France, Mallé sort nos poubelles et personne ne lui parle.
Sauf le cinéaste, qui se tient devant lui avec une caméra : chacun son fétiche.
LE FIL DE LA PAROLE
La rencontre avec Mallé est donc un malentendu — on pourrait le dire d'ailleurs de tous les personnages des films de Denis Gheerbrant, si l'on veut bien décomposer ce mot : mal entendu.
C'est parce qu'on a du mal à entendre ce que nous dit l'autre qu'il faut déployer un luxe d'attention autour de sa parole.
C'est au fil de l'eau, d'un canal ou d'un lac, que se font souvent les évocations des dieux, des légendes, des paysages de l'enfance, un fil qui joue comme métaphore de la mémoire.
Mais le fil de la parole, ce sont aussi ces conversations plus frontales dans le resserrement de sa chambre, d'un local, ponctuées par un troisième fil, celui du téléphone cette fois...
Le corps de Mallé est ici, mais sa tête est là-bas, sa tête et aussi son sang : là où sont sa femme et ses enfants.
Mallé en son exil donne à voir une parole écartelée, comme en témoignent ces scènes où le personnage raccroche subitement après de longues conversations avec des interlocuteurs que l'on devine souvent au pays.
Mallé est un corps présent et massif, le cinéaste l'aime et le filme, en boubou, souvent couché, beau comme un lion ou une montagne, mais Mallé est aussi une marionnette, son corps est relié à mille fils emmêlés là-bas, au pays, qui viennent l'animer de mouvements secrets.
Comme souvent dans ses films, Denis Gheerbrant joue de deux registres antagonistes pour faire entendre ce conflit : le plan-séquence dans sa durée, le raccord brutal de plan à plan.
On pourrait parler d'un « continu-cassé » où la parole n'est écoutée qu'à partir de ses interruptions.
« Couper, c'est faire entendre ce qui nous dépasse » me disait un jour Denis Gheerbrant.
En point d'orgue de ce fil repris et interrompu, l'eau, les fenêtres, le ciel, font les rimes de la partition écrite à deux mains.
QUI MÈNE LE JEU ?
Car il y a bien finalement deux paroles qui se confrontent dans le film, même si celle du cinéaste est plus discrète.
Le cinéma de Denis Gheerbrant n'enregistre pas la parole, il la crée.
Les rôles s'inversent parfois : le personnage met en scène le filmeur, le rend personnage à son tour, c'est une élaboration commune.
Cette tension entre deux corps, deux présences, s'exprime dans un très beau plan où la caméra, en un lent panoramique, relie le ciel, un arbre dans la cour, l'écran de télévision dans la chambre, une horloge affolée dont l'aiguille court sans fin, des vêtements suspendus, un calendrier, Mallé enfin, qui parle dans sa langue au téléphone sans se soucier du filmeur.
Le filmeur a pris soin, au milieu du plan, de signer sa présence : dans le reflet du miroir, il fait le point et inscrit son corps dans cet espace de la chambre qui devient celui du film.
Jusqu'où le filmeur et le filmé pourront-ils partager le même espace ?
Tant que Denis le cinéaste garde sa position de disciple, écoutant un Mallé détenteur de savoir, le contrat du film tient dans un cadre repéré, celui d'un geste de transmission.
Mais c'est un Français qui filme un Africain du Mali.
Et c'est quand Mallé dira : « Il y a deux choses là-bas que les Français sont contre ça, la polygamie et l'excision. » que les deux mondes vont se séparer...
Le cinéma direct tel que le pratique Denis Gheerbrant, dans une forme d'entêtement naïf, est scandaleux.
Il fait naître une fiction partageable dans la transe cinématographique, jusqu'au moment où une limite est posée au jeu qui semblait sans fin.
La grande fraternité égalitaire du cinéma débouche sur ce paradoxe : elle conduit à d'irréconciliables différences.
C'était déjà, il y a près de soixante ans, la leçon de Chronique d'un été.
À nouveau, dans Mallé en son exil, Mallé le personnage et Denis le cinéaste font surgir ce scandale de l'expérience du cinéma : rendre partageable l'impartageable, rendre égalitaire la tragédie des différences.
Laurent Roth
PARCE QUE C’ÉTAIT LUI, PARCE QUE C’ÉTAIT MOI (par DENIS GHEERBRANT)
Un homme filme un autre homme. « Parce que c'était lui, parce que c'était moi. »
Lui, parce qu'à sa manière unique, travailleur précaire vivant dans un foyer, il est à la fois pétri de la culture de ses ancêtres et au fait du mode de pensée occidental, de par sa curiosité et son éducation dans une école encore très française. Moi, parce que cinéaste qui aime filmer seul, dans le mouvement du quotidien, la parole de l'autre.
Lui et moi, parce qu'un jour Mallé m'a dit : « Tu me fais du bien, je te fais du bien. »
Le tournage s'est étalé sur cinq ans, nous nous voyions quasiment chaque semaine.
Au départ, je voulais filmer les travailleurs du nettoyage, les soutiers de notre économie, en tant que porteurs d'un monde qui nous reste étranger, invisible. De 2010 à 2011, j’ai assisté aux consultations juridiques d'un syndicat, parfois avec la caméra. Mais toutes les personnes que je rencontrais dans ces consultations refusaient de s'engager au-delà. J'en étais venu à penser que ceux qui étaient invisibles voulaient le rester, tout simplement pour se protéger.
J'ai expliqué mon projet à Mallé en deux mots et, contrairement aux autres, il m'a donné rendez-vous et m'a parlé d'une traite durant deux heures. Nous nous sommes revus très souvent, pendant deux mois, sans caméra. Et puis le tournage s'est enclenché tout naturellement : parfois en tête-à-tête, parfois à son travail ou parmi les siens.
M'emmener au foyer où il habitait, ce n'était pas rien, car les autres résidents ne comprenaient pas du tout ce qu'il fabriquait avec ce toubab.
Au fil du temps, le Français qui va voir Mallé dans sa chambre est devenu une silhouette familière.
Mallé et moi discutions sans arrêt.
Au début, il s'est fait le professeur de l'histoire à la fois factuelle et mythique du Mali. Très vite, nous nous sommes mis à converser comme deux compères.
« Ici c'est comme ça, chez nous ça se passe autrement. »
Cette conversation a formé le socle de notre relation, le lieu d'une indispensable confiance.
C'est l'acte même de filmer qui a imposé un autre registre, celui où s'exposaient nos différences.
C'est Mallé qui avançait chaque fois d'un pas quand je le filmais, qui m'apprenait par exemple qu'il avait une famille d'esclaves.
C'est la caméra qui a fait surgir les « questions qui fâchent » : l'esclavage, la polygamie, l'excision.
Le questionnement rebondissait d'un tournage à l'autre :
« Tu m'as parlé de tes esclaves, explique-moi ce que représente l'esclavage au Mali. »
De la description d'une société de castes, nous sommes passés à la « nécessité d'avoir un supérieur », et au rapport homme-femme qui nous a menés à la question de l'excision.
MES FILMS, UN PARTAGE D’EXPÉRIENCE
Mes films proposent avant tout le partage de mon expérience d'une réalité donnée.
Je filmais sans comprendre.
Mallé m'a tout traduit, une fois fini le tournage proprement dit.
Nous revenions à cette occasion sur les points que j'avais envie de creuser, notamment bien sûr la question de l'excision.
La nature de notre relation repose précisément sur nos différences.
La tension que l'on sent monter pour culminer à propos de l'excision désigne le contrat même du film.
Certaines déclarations de Mallé bousculent des valeurs que nous considérons universelles, alors même que mon cinéma fonctionne sur l'association du spectateur à une relation empathique avec les personnes filmées.
Quel travail proposez-vous ici aux spectateurs ?
D.G. —
Pour Mallé, le film était une occasion de mettre en forme son univers intérieur à l'épreuve de l'autre, dans la langue de l'autre. C'est alors que le Mallé qui sort les poubelles se met à incarner la civilisation de ses ancêtres. Un monde se substitue alors à un autre, et Mallé nous ouvre à cet univers dont il se dit « exilé ». Dans ce film, j'interroge quelqu'un d'ailleurs qui vit ici, à côté de nous. Il ne s'agit pas de se convaincre...
Propos recueillis par Marie-Pierre Duhamel Muller, le 19 octobre 2018.
FILMOGRAPHIE DE DENIS GHEERBRANT
Longs métrages documentaires :
- Printemps de square (1980 – 80 min)
- Amour rue de Lappe (1984 – 60 min)
- Question d'identité (1985 – 55 min) – Prix du Filmmaker, Bilan du film ethnographique
- Histoire de parole (1986 – 30 min)
- Et la vie (1991 – 90 min) – Prix de la compétition internationale et de la SCAM au festival « Vues sur les docs » Marseille 91
- La vie est immense et pleine de dangers (1994 – 80 min)
- Grands comme le monde (1998 – 90 min) – Festival de Cannes, sélection ACID
- Le voyage à la mer (2000 – 92 min) – Festival de Cannes, sélection ACID, Prix Planète Vues sur les docs Marseille
- Une lettre à Van der Keuken (2001 – 30 min)
- Après, un voyage dans le Rwanda (2004 – 105 min)
- La République Marseille (2009 – 7 films – 6h) – Festival du Cinéma du Réel
- On a grèvé (2014 – 70 min) – Festival du Cinéma du Réel
Tous les longs métrages, à l'exception du premier, sont sortis en salle.
-

Mallé en son exil
Langue : Multilingue
- Produit par L'atelier documentaire, en coproduction avec Les Films d’ici
- Année de sortie 2017
- Pays de production France
- Langue VF
- Zone de diffusion Monde
- Disponibilité Location / Vente
- Genre Documentaire
- Durée 1h46
- Identifiant Allociné 266448.